Nous publions l’interview que nous a accordé Philippe Marcelé, universitaire, dessinateur de bande dessinées qui est une excellente introduction à la discussion sur l’art.
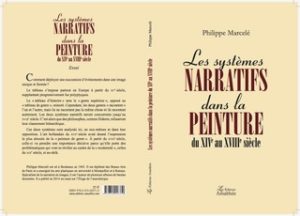
1 Ton livre est une étude matérialiste de la peinture depuis le XIV° siècle. Peux-tu présenter ton travail ?
Il est difficile de répondre en quelques mots à une question aussi générale. Disons, qu’adopter un point de vue matérialiste c’est se mettre en porte à faux avec tous les formalismes, largement dominants dans le discours institutionnel, pour qui les formes se développent dans le ciel de l’esprit indépendamment des conditions matérielles d’existence. Selon cette façon de voir les phénomènes artistiques existent en-soi et doivent être analysées en-soi. Je pense, à l’inverse, que l’art est un phénomène social, profondément immergé dans l’existence concrète des hommes et qu’on ne peut le penser en dehors de cette immersion. Que la relation entre l’art et le social soit complexe, dialectique, apparemment contradictoire – l’art étant capable d’une autonomie relative – n’enlève rien au fait qu’elle reste fondamentale et incontournable. Elle est à la fois le fondement méthodologique et la boussole qui permet de s’orienter, notamment face à la tendance de l’art à s’illusionner lui-même sur son autonomie.
Mon livre porte sur une période qui va du XIV° siècle aux premières années du XIX°. Il traite des systèmes narratifs dans les arts plastiques, dans une période assez vaste, mais globalement dominée par l’image unique donnée par le tableau. C’est là d’emblée, pour nous, un paradoxe. Nous sommes habitués à concevoir la narration en images à travers des médiums comme le cinéma ou la bande dessinée et nous avons du mal à accepter qu’une seule image, celle du tableau, puisse suffire à raconter une histoire. Pourtant, en 1436, Léon Battista Alberti, dans son livre fondateur de l’esthétique de la Renaissance intitulé De la Peinture, affirmait : « l’histoire est la grande affaire du peintre ». Jusqu’à la fin du XVIII° siècle, le « tableau d’histoire » sera placé au sommet de la « hiérarchie des genres ».
D’un point de vue matérialiste on ne peut comprendre les mutations artistiques qui s’opèrent à la Renaissance sans les mettre en relation avec les mutations sociales sous-jacentes qui se caractérisent, avant tout, par la montée de la bourgeoisie qui déjà aspire à s’imposer comme classe dominante et qui entend le manifester sur le plan de l’art. Il est frappant de constater que de nombreux commanditaires, y compris pour des œuvres destinées en prendre place dans les églises, sont des bourgeois. Ainsi Brancacci, qui disposait dans l’église Santa Maria del Carmine, à Florence d’une chapelle privée qu’il a fait décorer de fresques célèbres de Masaccio, Masolino et Filipino Lippi, était un riche drapier. Ce n’est qu’un exemple parmi de milliers d’autres.
Mais la bourgeoisie n’apportait pas seulement son argent. Elle apportait, bien plus fondamentalement, une nouvelle vision du monde centrée sur l’homme (l’humanisme) en tant qu’individu capable de construire son destin, en opposition au système féodal de classes héréditaires, entièrement soumis à l’autorité divine. Même si la société féodale subsistait et restait le système politique dominant, même si la religion et l’église (par ailleurs en crise) conservait sa puissance, même si les différences étaient considérables d’un pays (voire d’une région) à l’autre, globalement le centre de gravité sociale et historique ne s’en était pas moins déplacé de Dieu vers l’homme, ou plus exactement vers l’homme/individu. Ce que voyait cet homme, le monde physique réel, devenait donc la question centrale de l’art. Il faut : « noter comment les choses se présentent à la vue ». Tel est le programme que définit Alberti pour la peinture qui ne serait concernée que par le « visible ». C’est là le contenu véritable de l’« imitation de la nature », qui est tout autre chose qu’une recette académique comme elle a été présentée par un discours du XX° siècle, inspiré par une résurgence du spiritualisme.
Le tableau d’histoire met au centre l’histoire parce que c’est son histoire que met en œuvre l’homme agissant, aspirant à maitriser son destin. Unifié par la perspective autour du « point central » qui est le point de focalisation du regard d’un œil unique, il incarne le point de vue unique d’un spectateur unique situé en un lieu fixe et déterminé. Il est la projection sublimée de l’homme en tant qu’individu. C’est pourquoi, idéalement, il ne peut être vu que par un seul et unique individu, figé en un lieu et un temps unique. L’histoire mise en scène devra être condensée. C’est ainsi, par exemple, que dans le Frappement du rocher (1649), Poussin montre à la fois Moïse frappant le rocher pour en faire jaillir une source, l’abondance de cette source et un guerrier remplissant déjà son casque pour se désaltérer. Il est évident qu’on a là une juxtaposition impossible de temps forcément en succession. Si l’artiste ne « dispose que d’un instant » comme le disait le théoricien du classicisme qu’était Félibien, cet instant est en fait un conglomérat d’instants.
Le tableau d’histoire repose donc sur un concept paradoxal : il matérialise un temps hors du temps puisqu’il fige la succession événementielle en un temps unique. Comme l’ont montré de nombreux historiens d’art – mais plus particulièrement Sixten Ringbom – il prend forme à partir de l’icône, mais non telle quelle, par sa « narrativisation », c’est-à-dire par son insertion dans l’humain. En clair il réalise une sorte de fusion du divin et du profane, de l’intemporel et du temporel, ou si l’on préfère du sublime et du quotidien. C’est pourquoi, s’il humanise les dieux il divinise aussi l’homme. Son « homme » de prédilection sera donc un dieu ou un héros. Ayant son origine dans le Quattrocento italien, le tableau d’histoire trouvera son incarnation idéale au XVII° siècle dans la peinture du Poussin, mais c’est dans l’Académie Royale de peinture sous Louis XIV qu’il sera le plus complètement théorisé. C’est que le « roi-soleil » qui se présentait à fois comme humain et divin, devait voir dans le tableau d’histoire l’art dont il avait besoin. Pour Félibien, le rôle du peintre était de glorifier le roi.
Or, pouvant être tout aussi narratif que le tableau d’histoire mais s’opposant à lui, le tableau de genre méprisé par les classiques, ne s’intéresse pas aux dieux et aux héros, mais au quotidien et à l’ordinaire. Significativement, c’est aux Pays Bas, dans la république des Stadhouders, c’est-à-dire dans une région où pour des raisons historiques (guerre d’indépendance contre l’Espagne catholique et féodale) la bourgeoisie calviniste a pu s’imposer, que le tableau de genre trouve un terrain propice à son développement au XVII° siècle. Mais il va s’imposer partout en Europe à partir du XVIII° siècle. Diderot notamment, dans son Essai sur la peinture, refuse la hiérarchie des genres.
Le tableau de genre, comme le tableau d’histoire, propose une image unique. Mais son système narratif est radicalement différent. Il n’est pas unitaire et, au lieu de condenser la narration, il la suggère. Et cette nature différente de l’image a une réfraction dans la théorie de l’art. Diderot dégage l’histoire au terme d’un parcours qu’il nomme la « ligne de liaison » et Lessing, à la même époque, dit que le peintre doit fixer « le moment fécond », celui qui suggère et permet de reconstituer ce qui s’est passé avant et ce qui se passera après. L’avant et l’après sont donc renvoyés dans un hors-champ que le spectateur peut imaginer. Le tableau d’histoire proposait une image fermée et centripète; le tableau de genre propose une image ouverte et centrifuge. C’est cette dernière qui s’est imposée au XIX° siècle avec le triomphe de la bourgeoisie (révolution de 1789) et qui, à mon avis, perdure jusqu’à nos jours.
2 En conclusion tu insères la bande dessinée dans cette évolution, cela mérite des explications.
À mon avis, le problème n’est pas tant la bande dessinée, inventée par Töpffer dans la première moitié du XIX° siècle conjointement à la photographie, que dans ce que je viens de dire à propos de l’image centrifuge. Cependant, la bande dessinée est un bon exemple des mutations annoncées dès le XVIII siècle.
Dans son Cours de peinture par principe, publié en 1708, Roger de Piles écrivait, pensant aux suites narratives apparues à la Renaissance : « la peinture peut bien représenter tous les faits d’une histoire par ordre, en multipliant les tableaux, mais elle ne peut faire voir ni la cause ni la liaison ». Or précisément, la bande dessinée et plus tard le cinéma, produisent tous les jours des images qui font voir la « cause » et la « liaison ». Mais cela est apparu dès le XVIII° siècle, avec Hogarth notamment, dont se réclamait Töpffer.
Goya peint, en 1807, six petits tableaux (29,2 x 38,5 cm) racontant les différents épisodes (ou séquences) de l’arrestation du bandit El Maragato par le frère Zaldivia, (Institut d’art de Chicago). Il s’agissait de rendre compte d’un « fait divers » et on peut y voir la première manifestation d’un art du reportage. Mais ce qui importe ici, c’est qu’on n’est pas en présence de six petits tableaux indépendants dont chacun aurait sa valeur propre, mais d’une seule et même œuvre composée de six images interdépendantes. Bien que ce soit encore de petites peintures, tout le système de la bande dessinée se trouve là. La bande dessinée ne tombe donc pas du ciel. Comme la photographie, son émergence était contenue dans le développement artistique, lui-même reflet à sa manière, du développement historique.
Le tableau d’Histoire figé et centripète était devenu impossible face à la grande industrie d’une part et d’autre part face à l’apparition de nouvelles formes de pensée : théories de l’évolution en sciences et phénoménologie en philosophie. La Phénoménologie de l’Esprit de Hegel, paraît en 1807, la même année que Goya peignait son ensemble.